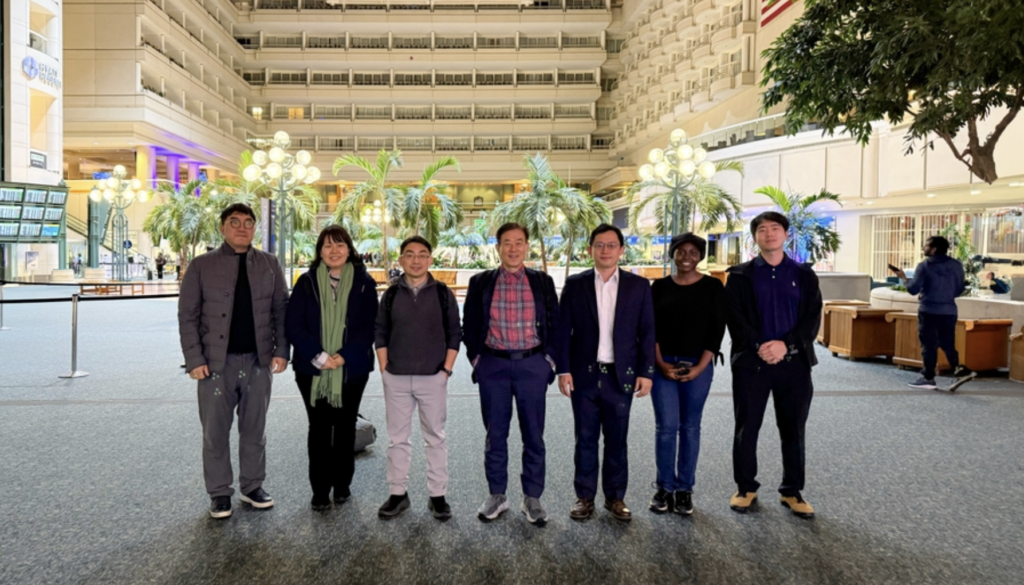1. The Prayer in Gethsemane and the Loneliness of Jesus Christ
Pastor David Jang offers profound insights into the loneliness of Jesus Christ revealed in the Garden of Gethsemane, as well as into His prayer there. Focusing on Mark 14:32–42, he vividly depicts Jesus’ emotions and circumstances as He faced the extreme suffering of the cross. In this passage, our Lord says, “My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death,” and He falls to the ground in earnest supplication, while His disciples, even in that critical hour, succumb to sleep. Emphasizing that Jesus provides a “true example of prayer,” Pastor David Jang also points out that this prayer is not simply a demonstration of “bold confidence”; rather, it contains profoundly human anguish and fear, expressed “with loud cries and tears” (Heb. 5:7). This, he says, is the crucial point.
Throughout His public ministry, Jesus performed many miracles, cast out demons, and healed the sick, proclaiming the kingdom of God. The disciples, having witnessed His mighty power repeatedly, may have believed that if He desired, He could avoid any suffering. Yet, as Pastor David Jang observes, the Lord did not choose a path of “evading suffering through divine power” as His disciples might have expected; rather, He walked the path of “whole-person obedience,” as revealed in the text. Jesus’ words, “Abba, Father, everything is possible for you…” (Mark 14:36), reflect absolute trust that “nothing is impossible with God.” At the same time, however, He concludes with, “Yet not what I will, but what you will.” Pastor David Jang calls this the most beautiful and majestic aspect of Jesus’ prayer.
This prayer contains a glimpse of Jesus’ fragile humanity, yet precisely because of this human fear combined with trust in God’s absolute sovereignty, it manifests “complete obedience.” In our own faith life, we often say, “I will obey God’s will,” but when we actually face real pain or fear, we find it hard to bear. Even Jesus prayed that this cup be taken from Him. That fact alone makes us acknowledge our weaknesses without pretense. And ultimately, when Jesus decides “to accept it if it is the Father’s will,” Pastor David Jang finds in this solitary prayer scene at Gethsemane a fundamental lesson for all believers.
According to Pastor David Jang, the prayer in Gethsemane is not just a historical note that “Jesus was troubled because He would soon die.” It is also a symbolic moment in which Christ, as the “Messiah (the Anointed One),” fully embraces the suffering set before Him. The name Gethsemane itself means “oil press,” and just as olives are crushed so that oil may flow from them, Jesus likewise experiences the utmost agony—His body and spirit pressed—for the purpose of becoming the “ransom for sinners.” According to Scripture, when a king was anointed in Israel, a prophet or priest would pour oil upon the king’s head. This act symbolized “kingship” and signified the calling of the anointed one to lead the people. Yet Jesus, though He was the “King,” did not immediately ascend to a throne of honor and glory; He instead chose suffering and death first—a truth implied in this passage.
During the Passover season in Jerusalem, the blood of countless sacrificial lambs flowed down the Kidron Valley after being offered at the temple, coloring the stream red. After the Last Supper, Jesus and His disciples crossed this Kidron stream to enter the Garden of Gethsemane. Pastor David Jang paints this scene as “the Savior’s lonely figure crossing a stream running red with blood,” highlighting that Jesus already knew His own blood would soon be poured out like that of these lambs. Contemplating the terrible death that lay ahead, He nonetheless took each step forward. Meanwhile, the disciples who should have accompanied Him in unity and resolve were singing songs as they entered Gethsemane, only to fall asleep rather than gird themselves with steadfast determination—further emphasizing Jesus’ isolation.
According to Pastor David Jang’s explanation, Jesus’ loneliness was not merely a result of “human betrayal.” Certainly, one of the Twelve, Judas, was already plotting to hand Him over, and the other disciples, failing even to comprehend their Lord’s suffering, fell asleep. Thus Jesus was compelled to lament, “Couldn’t you keep watch for one hour?” (Mark 14:37). Yet above all, His loneliness came from His calling as the One who must willingly fulfill “the will of God.” He had to persevere in obedience alone, bearing His unique mission, even when no one gave Him support, sympathy, or comfort. And still, He did not give up.
Pastor David Jang also notes that this loneliness corresponds to an inevitable thread that runs through Jesus’ entire life. From the early days of His ministry, Jesus was often misunderstood by people or overly revered by others, only to be rejected by the Jewish leaders of His own nation. Even His disciples did not genuinely recognize Him as the Messiah prior to the crucifixion, nor did they understand the values of the kingdom of God that He was advocating. Thus, although they responded “Amen” to His teachings, they did not truly reflect those teachings in their lives. When Jesus foretold His suffering, the disciples could not grasp what He meant or considered His words superficially. In the end, at Gethsemane, this collective ignorance and insensitivity took tangible form.
Jesus took only three disciples—Peter, James, and John—further into the garden with Him. According to the Synoptic Gospels (Matthew, Mark, and Luke), these three also witnessed Jesus’ transfiguration on the mountain. Pastor David Jang interprets their selection not so much as proof of their exceptional courage or faithfulness, but that the Lord chose them as the ones in whom He could confide His deepest anguish. However, as Jesus prayed in such distress that “His sweat was like drops of blood” (Luke 22:44), these same disciples were unable to keep watch. It was not merely a matter of physical sleep; rather, they had not mentally prepared themselves to confront the “extreme suffering” of the One they followed. In reality, the fact that they slept when He needed them most—when He was praying in agony—demonstrates vividly how weak they really were. Pastor David Jang repeatedly returns to the theme that “Jesus’ path is a path of loneliness,” a loneliness in which He nevertheless “clings utterly to the Father in prayer” and never abandons His mission.
Another detail not to be overlooked is Jesus’ prediction to Peter: “Before the rooster crows twice, you will disown me three times” (Mark 14:30). Peter, relying on his own resolve, had proclaimed loudly that he would never betray the Lord, even if it cost him his life. But ultimately, he failed. Pastor David Jang explains that this passage starkly contrasts “human resolve” with “obedience to God’s will.” Peter vowed, out of human willpower alone, “I will die for You, Lord,” but when Jesus was praying in Gethsemane, Peter had no spiritual vigilance to sustain him. Consequently, once Jesus was arrested, he panicked, fled, and even denied knowing Him—a truly wretched outcome.
Through Jesus’ prayer in Gethsemane, we glimpse two aspects simultaneously: one is the Lord’s frailty, as shown by His astonishment, sorrow, and earnest pleading; the other is His strength, as He voluntarily shoulders the cross, declaring, “Yet not what I will, but what you will” (Mark 14:36). Pastor David Jang stresses that this fusion of two seemingly opposite qualities encapsulates the essence of Jesus’ character and ministry. True spiritual boldness, he teaches, is by no means the product of “human callousness” or “simplistic thinking.” Rather, it arises from “obedience to God even when confronting suffering head-on.”
We often mistakenly believe that “strong faith means no fear of suffering.” Yet according to Pastor David Jang, Jesus, who feared suffering, chose instead to overcome that fear. He did so by “pouring out everything to the Father in prayer and then rising again to walk toward the cross.” We may call this a “lonely path,” because it was a path that belonged solely to Jesus, a path no one else could walk in His place. Pastor David Jang encourages us, “When you feel abandoned in life’s darkest valley, remember how Jesus prayed.” In that night when the entire world slept and even those who should have stood by Him had disappeared, Jesus called God “Abba” and entrusted everything to Him in submission—and that image remains the ultimate model for believers.
In the Gospel of John, we do not find a direct account of Jesus’ Gethsemane prayer. Instead, from chapters 13 to 16 we read the Last Supper and His farewell discourse, then chapter 17 records His extended “high priestly prayer,” followed by His arrest in chapter 18. Pastor David Jang suggests that John emphasizes that Jesus’ resolution occurred already at the Last Supper (John 13:1ff). The Synoptic Gospels (Matthew, Mark, Luke) shine a spotlight on Jesus’ “inner conflict” in Gethsemane, but in John’s Gospel, Jesus appears to have already embraced His suffering as “glory,” saying, “Now the Son of Man is glorified” (John 13:31). Yet from Mark 14, we learn about the tears and loud cries that accompanied Jesus’ decision. Hence, Pastor David Jang reminds us to read the Synoptic Gospels and John’s Gospel as complementary accounts.
In sum, the Gethsemane prayer passage does not highlight merely Jesus’ “perfect divinity.” Instead, it makes plain His harrowing human side, revealing the resolve behind His sacrifice. The fear and pain ultimately merge into total trust in the Father, culminating in Jesus’ courageous decision to go to the cross. As Pastor David Jang stresses, from this incident we learn how formidable yet beautiful it is to “obey God’s will.” Even within Jesus, there was the very human plea, “Take this cup from me,” and simultaneously the spiritual commitment, “Yet not what I will, but what you will.” Therefore, in our own lives, in times of adversity and distress, we should strive to follow Jesus’ example, ultimately praying not for “my will” but for “God’s will” to be done.
Moreover, Pastor David Jang underscores that the Gethsemane story is not simply something that happened one night in ancient Jerusalem—it still applies to God’s people today. When we are at a crossroads, or confronted by unexpected tests and sufferings, we too need our own “Gethsemane prayer.” This prayer is not merely “God, give me strength,” but like Jesus, an honest confession of all our frailty and fear, followed by a request that “the Father’s will be done” despite it all. Pastor David Jang says, “In the lonely night of life, when no one seems to be at your side, that is precisely when you must call upon ‘Abba, Father’ and stand in the power of the Holy Spirit.” This, he insists, is how we follow the holy footsteps of Jesus.
Looking further, Jesus’ loneliness in Gethsemane was a “necessary choice for our salvation.” Had it not been necessary for Him, as the Son of God, to endure such desolate agony, He would not have. But Pastor David Jang emphasizes that “to redeem sinners,” Jesus did not shy away from that path. No matter how deeply we attempt to grasp Jesus’ heart, it is almost impossible to fully comprehend the obedience that led Him to “obedience unto death.” Yet Scripture’s detailed witness to that fact, Mark’s clear portrayal of Jesus’ tears and sweat, and the exposition of these truths by pastors like David Jang all have a definite purpose. Namely, they invite us to contemplate that lonely night, to realize more profoundly the grace and love of the Lord, and to learn the path of lonely obedience in our own lives.
Ultimately, the Gethsemane prayer ends with Jesus announcing, “The hour has come. Look, the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise! Let us go!” (Mark 14:41–42). Pastor David Jang calls this Jesus’ “holy advance,” the beginning of redemption that transcends loneliness. Even in tears and anguish, when Jesus says, “Let us go!” He is not only declaring His own decision, but also summoning us to “join Him on this path of suffering.” Thus, we find the meaning of “walking together.” Originally, the disciples should have accompanied Him, but in reality, they all fled, leaving the Lord to bear the cross alone. Later, though, through His resurrection and the outpouring of the Holy Spirit, the disciples rejoined His path, and the church continues the legacy of “suffering and glory.” Pastor David Jang concludes, “Even today, both the church and individual believers must remain as vigilant in prayer as though we were in Gethsemane.” Indeed, only by participating in Jesus’ loneliness and suffering can we move closer to fulfilling God’s will.
2. The Weakness of Peter and the Other Disciples, and the Path of Discipleship
Following the scene in Gethsemane, Pastor David Jang carefully examines the latter portion of Mark 14, which depicts Peter and the other disciples. Specifically, Mark 14:50 and onward recounts the disciples fleeing after Jesus is arrested and Peter’s threefold denial. Then in Mark 14:51–52, a young man “wearing nothing but a linen garment” tries to follow Jesus but, when seized by the mob, leaves his garment and escapes naked. Tradition often interprets this young man as Mark himself, the author of the Gospel. Pastor David Jang references this tradition, remarking that the Gospel’s candid portrayal of “cowardice” and “fear” on the part of the disciples and Mark is a hallmark of the Gospel’s raw honesty.
Indeed, all of Jesus’ disciples had vowed to stand by Him to the end. Peter declared, “Even if all fall away, I will not” (Mark 14:29). But that determination ultimately collapsed, and Peter’s proud promise proved hollow. This was not just Peter’s failing, but evidence of the “weakness” shared by all humanity. Pastor David Jang notes that many people, too, sincerely believe, “I will never betray the Lord, no matter the circumstances,” yet when physical danger and fear arise, our instincts take over. No matter how devout a person may appear, when confronted by severe temptation or the world’s pressures, we can quickly crumble.
Still, the lesson does not end there. The Gospel also shows that Peter, having denied Jesus, tasted bitter remorse, and ultimately repented, returning to his position as a disciple (John 21 describes the resurrected Christ restoring Peter). Pastor David Jang says this illustrates “disciples who, despite their frailties, were still used by the Lord.” Sleeping through Gethsemane, fleeing at Jesus’ arrest, and even betraying or denying Him in shame—these are all unflattering and disgraceful behaviors. Yet after the resurrection, Jesus came to them again. Their failure was not permanent abandonment. The “cowardly disciples” were transformed into the “great apostles,” making the grace of the Gospel all the more striking. Pastor David Jang says, “The Lord’s love is greater than our failures.”
One figure especially worth noting here is “Mark,” the traditionally acknowledged author of the Gospel of Mark. Pastor David Jang points out the significance of Mark recording in his own Gospel the embarrassing incident of his nighttime flight in 14:51–52. Many would prefer to hide such a past, yet the Gospel instead discloses these failures to emphasize that “humans are weak. But Jesus does not abandon us in our weakness.” Mark had been so eager to stay near the Lord that he followed in only a linen cloth. However, when the mob seized him, terror seized him as well, and he ran away naked—utterly failing to stand by Jesus. Including this failing in the Gospel actually underscores the gravity of the cross. “Even those closest to Him abandoned Him, and in such a pitiful, shameful way.” This detail adds weight to the loneliness of Jesus’ sacrifice.
Pastor David Jang underscores this point in his preaching. “If Peter, Mark, and the other disciples had not failed, would Jesus’ lonely obedience and sacrifice affect us so deeply?” After Pentecost, recounted in the Acts of the Apostles, these disciples were radically changed by the power of the Holy Spirit, leading a revival of gospel proclamation. Yet their starting point was “shameful betrayal, abandonment, and ignorance.” Paradoxically, this demonstrates the power of the Gospel and the grace of Jesus Christ. Faith is not a privilege of the “perfect” but is given to those who are “acutely aware of their shortcomings” and who receive God’s love and forgiveness.
Building on that point, Pastor David Jang concludes: “Though we often deny the Lord or fail to stand by Him, such failure is not the end. When we repent and return, God will use us as His witnesses.” This message is not confined to first-century disciples but applies to believers today. We can fail in countless ways in daily life or on the mission field. Like Peter, we may have once declared, “I will never abandon you,” yet when trouble arrives, we do not pray, and we fall. However, just as Jesus restored Peter, we too can repent and “strengthen our brothers” (Luke 22:32).
Pastor David Jang stresses the core of the Gospel: “Even if we fall, God does not abandon us. He knows our weakness and raises us up again.” He points to Peter’s bitter weeping and his threefold restoration at Jesus’ question, “Do you love me?” (John 21). “No life ends in failure; when we acknowledge our mistakes and repent, God can work through them too,” he says. Therefore, like Peter and Mark, even in our lowest moments, we can turn to the Lord, share in His resurrection victory, and be used for His purposes.
This disciples’ weakness also highlights “the utter solitude with which Jesus bore the cross.” The crucifixion is the most pivotal act of sacrifice in human history, and Jesus bore it by Himself. Certainly, the disciples crossed the Kidron Valley with Him and accompanied Him into Gethsemane, but at the decisive point, Jesus was alone. Pastor David Jang says this reveals the fundamental character of salvation: “We might wish to help shoulder Jesus’ burden somehow, but no one can remedy the problem of sin. Only Jesus could accomplish it.”
Hence, the Christian journey too becomes paradoxical. On the one hand, Jesus calls us with the words “Let us go!” and establishes us as the church together. On the other hand, each of us realizes we have our own cross that we alone must carry. That is, while we surely need the prayers and encouragement of the community, ultimately there will come a decisive moment requiring “my personal commitment.” Pastor David Jang reminds us of Jesus’ command, “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me” (Matt. 16:24). The disciples’ dozing in Gethsemane discloses the real state of affairs—everyone is tested, as though burdened by heavy eyelids, and if we rely only on human will, we fall as Peter did.
What, then, is the solution for this failure? Pastor David Jang repeatedly points to “Jesus’ prayer as our model.” Like Jesus, who prayed, “Abba, Father, everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will,” so must we come to God in total trust. “This is exactly the prayer the disciples needed in that moment, and it’s what we need too,” he explains. The disciples failed to stay awake in that hour, but they learned from the experience. Filled with the Holy Spirit later on, they demonstrated “martyr-like faith” that was prepared to die for the Gospel. Scripture repeatedly shows that those who fall and repent often become stronger in faith than those who have never faced adversity.
Thus, Pastor David Jang commends the Gospels’ “honesty in not hiding the failings of Peter, Mark, or the other disciples,” assuring us that this candor brings hope to modern believers. If Scripture said, “The disciples were always exemplary; there was no betrayal,” none of our brokenness would find resonance in its pages. But the Gospel writers openly reveal their weaknesses while testifying that Jesus forgave them and raised them up, proving that “the place where our frailty is most exposed is exactly where Christ’s grace shines brightest.”
Pastor David Jang asserts that, collectively, this shows us the “path of faith.” To become a believer does not mean becoming “an infallible saint who never fails.” On the contrary, when we fail and see the depth of our limitations, we at last rely wholly on Jesus. Like Peter, we may boldly pledge to follow the Lord wherever He goes, but if we break that promise, Jesus’ love does not diminish. After His resurrection, Jesus came to Peter again and said, “Feed my sheep.” This was not just for Peter but is also comfort and calling for us all.
The loneliness of Jesus in Gethsemane, and the disciples’ insufficiency, together guide us to explore what “true discipleship” looks like. Discipleship is not completed by words alone—“Lord, I will never betray you!”—but by the one who falls and prays, “Lord, have mercy on me, and restore me.” Pastor David Jang suggests, “This is the story of the Gospel, and the journey of faith follows this cycle repeatedly.” Each of us faces moments of collapse and weakness, yet by remembering Jesus’ prayer in Gethsemane and Peter’s failure-turned-restoration, we can return to the path of discipleship. This is no mere worldly motto such as “If you fall ten times, just get up an eleventh time.” Rather, it is the truth that “the Lord will never let us go.”
Hence, Pastor David Jang specifically teaches that “when we see weakness in one another within the church, instead of condemning, we must confess, ‘I too am among the weak,’ and build each other up.” If, when Peter failed, the other disciples had merely turned on him, that would not have been the Gospel way. But Jesus united them, convicting not just Peter but all the disciples of their own failings, preparing them for the birth of the early church as portrayed in Acts. In time, the church came together in love, prayer, mutual sharing, and mutual restoration for those who stumbled. This was the tangible realization of “walking with Christ.” After the cross came the resurrection, the outpouring of the Holy Spirit, and the formation of the church—transforming the slumbering disciples of Gethsemane into a community that “keeps watch and prays.”
All of this leads Pastor David Jang to remind believers of the following conclusions: First, Jesus’ way was “a path of loneliness” from beginning to end, one He walked alone for the sake of sinners. Second, the disciples failed to understand that path and either fled or denied Him, yet Jesus forgave and restored them, ultimately using them as apostles to spread the Good News. This shows that our own weaknesses are likewise redeemable within God’s saving plan. Third, by applying this story of “the cross and restoration” to ourselves, especially in times of suffering or despair, we can look to the One who prayed in Gethsemane and rise again when we fall.
All of this converges on “the prayer of Gethsemane,” where Jesus’ perfect submission to the Father unfolds and salvation’s history is set into motion. The cross, which Jesus hailed as “glory,” moves Him to summon the disciples—despite their failure—to “go together.” Pastor David Jang sees in this the call for us to follow Him, take up our own cross, and yet never lose hope in the “community of the resurrection.” Even in the midst of affliction, calling upon “Abba, Father” and proclaiming “Your will be done” is the essence of Christian faith. Mark 14’s vivid portrayal of Jesus’ anguish and the disciples’ failing shows how real and strenuous that faith can be in the human experience.
By viewing both Jesus’ Gethsemane prayer and the disciples’ weaknesses together, we realize the night of the cross is not just about Jesus’ suffering—it speaks to the “suffering and salvation” of all humanity in God’s grand design of redemption. As Pastor David Jang puts it, “That night, when Jesus wept most bitterly, was also the moment when God the Father’s love shone most brightly.” Ironically, the disciples’ sleep, betrayal, and desertion “reveal humanity’s sinfulness in its rawest form, proving that no one could be saved without Christ’s atoning work.” Yet the Gospel’s conclusion in the resurrection offers us hope: Peter, who once boasted in himself, eventually stumbled, and yet rose to become a pivotal leader in the early church. Likewise, though we may be haunted by guilt or by having once fled from the Lord, there is still a way to stand again and follow Him.
Though Gethsemane seems the height of sorrow and loneliness, Pastor David Jang calls it the “dawning of God’s kingdom,” because it was through that very prayer that Jesus took up the cross, ushering in the resurrection. The disciples slept that night but awakened after the resurrection and the coming of the Holy Spirit—transitioning to “awake disciples.” We too, reflecting on Gethsemane, can hear Christ’s command to “stay awake and pray.” Whether our road is far easier than Christ’s or unimaginably more difficult, we find assurance knowing that “He walked that lonely path for our sake,” and now He extends the invitation to join Him on that journey.
This is precisely what Pastor David Jang means by “walking with Christ.” Even though Jesus prayed in Gethsemane alone, that prayer was an intercession for us as well. The disciples slept, but in the end, they were restored and used in building God’s kingdom. Likewise, we can pray, “Lord, I wanted to stay awake, but I fell asleep. Wake me up, Lord,” and experience His grace as He lifts us again. Each year as we commemorate Lent and Easter, we do more than observe dates on a calendar. We affirm that the salvation forged through Christ’s lonely obedience is “still real for us today,” Pastor David Jang concludes.
Pastor David Jang often poses the question in his sermons: “If I had been there that night with Jesus, what would I have done?” He candidly admits, “I likely would have fallen asleep and run away like the rest.” Thus, our human frailty is no different from that of the disciples. It is precisely because of that weakness that we need “the grace of Christ.” Because Jesus alone was faithful and perfect, we can have hope despite our failures. This, Pastor David Jang insists, is why the Gethsemane account remains so relevant to believers today.
The essence of “walking with Christ” is not a path free of trials and hardship. Jesus’ journey was that of the cross, a path marked in Gethsemane by tears and deep prayer—and that path secured our salvation. The disciples did not walk it well that night, but following the resurrection, each took up his own cross in turn. For us too, this is the path of pain and grace, and to walk it is enough. Discipleship does not end every time we fall. Rather, we rise up again, fix our eyes on the Lord, and keep going. Though Jesus’ loneliness was profound, it initiated the redemption of all humanity and eventually called weak disciples like us back into His service.
Throughout this process, Pastor David Jang never lets us forget the simple prayer containing Jesus’ trust and love: “Abba, Father.” That we can call God “Abba” is possible only because Jesus obeyed, even to the point of death, opening the way for us to be God’s children. Because of that grace, those who have failed—like the disciples who fell asleep or Mark who ran away naked—can return to the community of believers and awaken in prayer. “Not my will, but yours be done.” This confession, spanning both cross and resurrection, is the heart of the Gospel, and the key to our healing and triumph. As Pastor David Jang puts it, “We are prone to despair again and again, but thanks to Jesus’ obedience, an unending road of grace is opened to us.” The long night in Gethsemane was the place where that gracious road began.
We experience similar moments in our own lives. When we face unexplainable afflictions, injustices, or fears, we pray, “Take this cup from me.” Then we recall the path Jesus showed us. No matter how deep our discouragement, or how great our shame, if we trust in the cross and resurrection, we can stand again. Jesus has gone before us, and He has redeemed the disciples’ failings. Ultimately, all of this hinges on God’s sovereignty and love, which we embrace in the Gethsemane prayer. Pastor David Jang’s message is clear: “Walking with the Lord means repeating that prayer in our daily lives.” Through that repeated prayer, our human frailty, like that of the disciples, is transformed by God’s will.
Mark 14’s account of Jesus’ prayer in Gethsemane, along with His profound loneliness and the pitiful weakness of Peter and the other disciples, reveals how priceless the grace of “walking with Christ” is—and how that new way remains open to us. Though that night of suffering appeared to end in tragedy, it was actually followed by Jesus’ words, “Rise! Let us go!” (Mark 14:42), leading ultimately to the cross, the resurrection, and the birth of the church. Pastor David Jang emphasizes that even today we must “enter Gethsemane in prayer, calling out, ‘Abba, Father!’ and staying alert.” For in doing so, we experience the power of the resurrection in real time.
Indeed, the Gethsemane prayer and the disciples’ frailty comprise one of the clearest depictions of the Gospel’s essence. The loneliness Jesus endured reminds us of the meaning of “true obedience,” and the disciples, who faltered in His presence, demonstrate that even in weakness we can ultimately become “people of God’s calling.” Even our defeats need not be final, because the Lord opens a path forward. Therefore, the most blessed way for a believer is to “join Jesus in prayer at Gethsemane.” There, and only there, do we learn to live “not my will but yours,” the life of discipleship. This is the crux of Pastor David Jang’s recurring theme of “walking with Christ,” the reason why the night in the Garden of Gethsemane must still captivate our hearts today.
www.davidjang.org